Recherchez sur le site !
Recherche avancée / SpécifiqueCatégories publications
+ Sciences De La Terre - Archéologie - Astronomie - Spéléologie - Ecologie - Pédologie - Volcanologie - L'hydrogéologie - Géomorphologie - Minéralogie - Pétrologie - Paléontologie - Géologie + Climatologie - Réchouffement climatique - Changement climatique + Plantes - Plantes Aromatiques - Plantes médicinales + Zoologie - Faunes + Botanique - Flors + Sciences humaines - Géo Eco Tourisme - L’anthropologie - L'Histoire - Démographie - Sociologie - Géographie - Patrimoine culturel
Géo éco tourisme inclusif

Géoparc et Recherche Scientifique
Le coins de l’étudiant



Blog Géoparc Jbel Bani
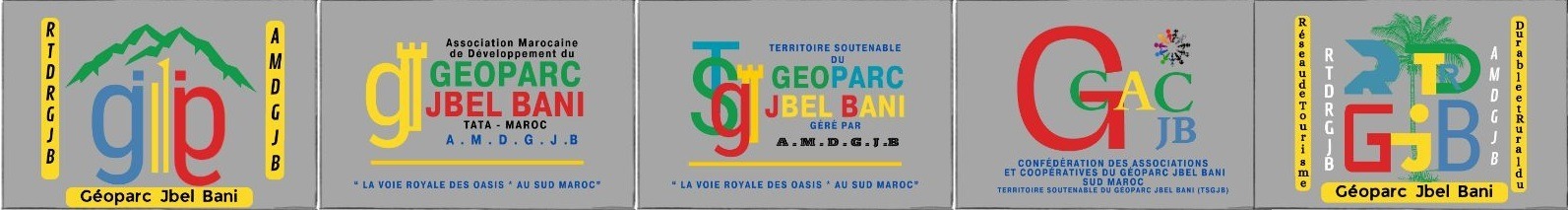
Géomorphosites du Sud marocain : Le cas des « Coeurs de Tata » comme ressources pour un géotourisme durable
Résumé
En empruntant les principaux circuits routiers de la région de Tata, dans le Sud marocain, certains versants de la chaîne hercynienne montrent des dépressions décamétriques à hectométriques dont le contour, souligné par certaines couches géologiques saillantes, dessine une forme de cœur, ayant la pointe dirigée vers le bas. Ces dépressions, uniques dans leur genre, présentent une sculpture naturelle particulièrement éloquente très répandue dans cette région. Il s'agit de véritables chefs d'œuvres de la nature qu'on appellera les "cœurs de Tata", dont la valorisation commence par faire connaître ses composantes à travers un inventaire ; puis, par expliquer leur mode de formation et enfin la raison de leur concentration dans cet espace géographique. La morphogenèse de ces structures a été conditionnée par plusieurs paramètres (nature lithologique des roches, le style de plis, la densité et la superposition des familles de réseaux de diaclases, la diversité des processus d'érosion et d'altération, les étages bioclimatiques), ayant affecté une série plissée, au niveau des zones les plus vulnérables que sont les points d'intersection entre les diaclases transversales et les diaclases longitudinales ; ce qui aboutit à la formation de ce genre de structures en forme de cœurs.
Abstract
By borrowing the main road circuits of Tata region, in southern Morocco, some slopes of the Hercynian range show decametric to hectometric depressions whose outline, underlined by some protruding geological layers, draws a heart shape, with the point directed down. These depressions, unique in their kind, present a particularly eloquent natural sculpture very widespread in this region. These are true masterpieces of nature that we will call the " Tata hearts", the valuation of which begins by making known its components through an inventory; then, by explaining their mode of formation; and finally, the reason for their concentration in this geographical space. The morphogenesis of these structures was conditioned by several parameters (lithological nature of the rocks, the style of folds, the density and the superposition of joints networks families, the diversity of erosion and weathering processes, bioclimatic stages) , having affected a folded series, at the level of the most vulnerable zones, which are the points of intersection between the transverse joints and the longitudinal joints; which results in the formation of this kind of heart-shaped structures.
Introduction
Le Géoparc du Jbel Bani (Fig. 1), que nous avons initié en 2013, fait partie de l'Anti-Atlas marocain (Gentil,1929 ; Destombes, 1960). Ce dernier correspond à une chaîne montagneuse au Sud du Haut-Atlas qui s'étend sur environ 750 km de long et 250 km de large, suivant une direction SW-NE, depuis l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'en Algérie au sud-est (Fig. 2). Il est limité au Nord par une zone de fractures dite accident majeur sud-atlasique (AMSA) et au Sud et SSE par le bassin paléozoïque de Tindouf. L'Anti-Atlas constitue la bordure nord du craton ouest-africain avec un soubassement éburnéen et panafricain qui affleure au niveau de plusieurs boutonnières de taille variable (Bas Dra, Ifni, Kerdous, Ighrem, Zenaga, Bou Azzer, Saghro, Ougnat) représentant le prolongement septentrional du Craton ouest-africain et une épaisse couverture paléozoïque, déformée lors de l'orogenèse hercynienne. Il correspond à un vaste anticlinorium dissymétrique de direction ENE-WSW. La couverture mésozoïque constitue les Hamadas restées tabulaires.
L'un des traits remarquables du Géoparc du Jbel Bani réside dans la présence de sculptures naturelles façonnées par l'érosion. Sur certains versants de cette chaîne hercynienne, en bordure des oasis, on observe des dépressions de taille décamétrique à hectométrique. Leur contour, souligné par des couches géologiques de lithologies contrastées, dessine des formes évoquant un cœur, dont la pointe est orientée vers le bas. Ces dépressions, véritables sculptures naturelles, se distinguent par leur forme évocatrice et sont particulièrement répandues dans la région de Tata. Uniques en leur genre, elles constituent de véritables chefs-d'œuvre géomorphologiques que l'on propose de désigner sous le nom de « cœurs de Tata ». Leur valorisation en tant que monuments géologiques à vocation géotouristique commence par leur identification et leur inventaire dans l'espace géographique régional. Plusieurs interrogations émergent alors : comment les localiser et les recenser ? Pourquoi une telle concentration dans la région de Tata ? Quels processus ont présidé à leur formation ? Quels paramètres géodynamiques ont influencé leur morphogenèse ? Existe-t-il des liens entre ces formes en cœur et d'autres géomorphosites locaux ? Enfin, quels bénéfices peut-on attendre de leur valorisation en termes d'éducation, de culture et de développement socio-économique pour le sud marocain ? Autant de questions auxquelles ce travail s'efforcera d'apporter des réponses.
Aperçu géomorphologique
Le relief actuel de l'Anti-Atlas est relativement jeune; résultant d'un soulèvement intervenu au Mio-Pliocène, il y a environ 11 Ma. Ce mouvement tectonique, associé à la mise en place de la chaîne atlasique (Bourkhard et al., 2006), s'est accompagné d'émissions volcaniques localisées notamment dans les massifs du Sirwa et du Saghro (Missenard et al., 2006). Ce soulèvement a permis l'installation du réseau hydrographique actuel, amorçant une profonde dissection du relief et activant l'action des agents d'érosion, à l'origine des formes variées que l'on observe aujourd'hui. Dans la région de Tata, ces processus ont sculpté de vastes vallées et bassins récents, creusés dans des formations tendres, tandis que les roches plus résistantes ont conservé des formes de collines arrondies ou de cuestas dominant les dépressions. L'ensemble des grands traits géomorphologiques de la région s'organise selon une disposition orientée du Sud et du Sud-Est vers le Nord et le Nord-Ouest, en cinq unités morpho-structurales distinctes (Choubert, 1952 ; Choubert et al., 1963; Hollard, 1967 ; Destombes, 1971 ; Becker et al., 2004 ; El Hassani, 2004) (Fig. 3).
. La plaine du Drâa et les Richs : La plaine du Drâa se caractérise par de vastes étendues planes et caillouteuses, appelées regs, ponctuées de crêtes rocheuses discontinues et plus ou moins émoussées, dont l'orientation suit généralement l'alignement du Jbel Bani. Ces élévations, localement appelées « Rich », sont formées de roches carbonatées et détritiques datant du Siluro-Dévonien (Destombes et al., 1985). Elles émergent du paysage en contrastant avec la monotonie apparente des regs, apportant une diversité géomorphologique notable à la plaine.
. Le Jbel Bani et les Foum : Le Jbel Bani est une chaîne montagneuse subrectiligne qui présente un relief de type appalachien en modèle réduit (Hollard, 1967 ; Destombes, 1971, 1976). Il s'agit d'une longue élévation étroite, aux flancs abrupts et à la crête relativement continue. Son altitude dépasse les 600 mètres et atteint un maximum de 1641 mètres au niveau de Foum Zguid. Constitué principalement de formations ordoviciennes, le massif présente une succession de schistes et de pélites à sa base, surmontés par des grès et des quartzites au sommet. Il s'etend sur environ 400 kilometres au sud de l'Anti-Atlas. Le Jbel Bani est entaillé perpendiculairement à sa direction générale par de nombreux cours d'eau, qui y ont creusé des cluses appelees localement « Foums ». Parmi les plus connues, d'ouest en est, on trouve : Foum El Hisn (ou Foum El Hassane), Foum Icht, Ait Ouabelli, Foum Akka, Foum Addis, Foum Tata, Foum Tissint et Foum Zguid. Ces points de passage, situés au cœur des vallées, concentrent les principales agglomérations de la région de Tata, en raison de la fertilité des sols, de la disponibilité en eau souterraine et de la présence de nappes phréatiques alimentées par les cours d'eau. Le niveau piézométrique y est généralement proche de la surface et peut même émerger grâce à la présence de seuils hydrogéologiques. Ces conditions ont favorisé, au fil du temps, l'installation d'oasis de type « Foum », véritables foyers de vie abritant certaines des plus importantes palmeraies d'Afrique du Nord ;
Les « Coeurs de Tata » : Géomorphosites du Sud marocain
Figure 1 : Situation du géoparc Jbel Bani et répartition des géomorphosites en forme de coeurs dans la région Tata
Figure 2 : Carte geologique simplifiee du domaine de l'Anti Atlas (d'apres Soulaimani et Burkhard, 2008) qui montre un ensemble de boutonnières précambriennes recouvertes par les séries du Paléozoïque.
. Les Feijas : Les Feijas sont de vastes cuvettes synclinales, planes et relativement rectilignes, remplies de sédiments quaternaires tels que les limons, conglomérats, travertins et calcaires lacustres. Ces dépôts reposent en discordance angulaire sur un substratum pélitique d'âge cambrien à ordovicien. Dans plusieurs secteurs, ces plaines sont traversées par des crêtes rectilignes, parallèles à l'orientation du Jbel Bani, qui les subdivisent en Feijas internes et externes. Ces crêtes sont formées de grès connus sous le nom de « Grès du Tabanit ». Les Feijas abritent des aquifères alluvionnaires exploités en aval des Foums pour irriguer les palmeraies. Ces nappes sont principalement alimentées par l'infiltration des eaux de crue, par les sous-écoulements des oueds à leur sortie des reliefs, ainsi que par les infiltrations issues des formations carbonatées karstiques des montagnes voisines. Ce contexte hydrogéologique favorable a permis l'installation de petites palmeraies dans ces dépressions fertiles (Ouanaimi & Soulaimani, 2011). ;
. Les reliefs montagneux de Tata : Le domaine des reliefs montagneux correspond à de vastes élévations topographiques qui façonnent des paysages variés, rares et d'un grand intérêt esthétique. Ces reliefs, parfois spectaculaires, sont entaillés par de grands cours d'eau qui ont creusé des vallées étroites et profondément encaissées dans les formations cambriennes et infracambriennes encadrant la boutonnière précambrienne de Tagragra d'Akka. Ces gorges impressionnantes offrent un caractère visuel remarquable. Les altitudes atteignent jusqu'à 1300 mètres au nord d'Akka et culminent à 1650 mètres au nord de Tata. Le relief se compose de collines plus ou moins émoussées, présentant fréquemment des formes escarpées, ponctuées de mini-falaises et de sommets tabulaires qui dessinent des cuestas bien marquées ;
· Les boutonnières précambriennes se composent de roches protérozoïques à teinte sombre, en grande partie en raison de la patine désertique qui les recouvre. Ces affleurements anciens contrastent nettement avec les terrains plus clairs de l'Ediacarien terminal et du Paléozoïque inférieur qui les surmontent. Leurs bordures sont souvent marquées par de puissants escarpements, soulignant leur importance morphostructurale dans le paysage (Thomas, et al., 2004).
Figure 3 : Vue aérienne des différentes unités géomorphologiques de la région d’AKKa Caractères morpho-structuraux
Les dépressions en forme de cœur sont sculptées sur des versants alignés suivant la direction du plan de la stratification des couches (Fig. 4). Ces dernières sont horizontales ou subhorizontales (H) au sommet des «cœurs de Tata» alors qu'au niveau des pentes, elles sont inclinées vers l'observateur (I). La zone axiale «cœurs de Tata» (A) se localise généralement au 1/3 supérieur de la pente du versant ; elle marque le passage du plan de stratification horizontal à celui du plan incliné vers l'observateur.
Les « Coeurs de Tata » : Géomorphosites du Sud marocain
Figure 4: Morpho-structure des dépressions en forme de cœur la région d'Igouliz dans la région de Tata
Les «cœurs de Tata » se développent dans des roches sédimentaires faiblement plissées ou flexurées, caractérisées par un grand rayon de courbure (Fig. 4). Leur repérage repose sur l'observation du pendage des couches géologiques par rapport aux versants. Ces formes sont intimement liées à des structures plissées : il suffit d'observer l'évolution du pendage depuis le sommet jusqu'à la base d'un versant pour en déduire la direction de la structure, généralement parallèle à l'axe des dépressions en forme de cœur. La pointe des « cœurs de Tata » se termine par un ravin (R) qui assure le drainage des produits d'érosion vers la base du versant. Ces matériaux s'accumulent au fil du temps en formant des cônes de déjection, dont la coalescence donne naissance à un glacis (G), fertile et favorable à l'installation de palmeraies. Ces formations sont souvent associées à un autre type de modelé remarquable, dit « fer à repasser ». Celui-ci est constitué de chevrons rocheux (C) séparés par des vallées transversales en "V", qui découpent les versants. Vu de face, ce relief évoque une succession de plis ; pourtant, il s'agit d'un effet d'optique. Une observation de profil révèle que les couches géologiques sont monoclinales ou légèrement arquées, et que l'aspect plissé est simplement le résultat d'une érosion transversale à leur direction. La présence de ce modelé « fer à repasser » constitue un bon indicateur de la possible existence de « cœurs de Tata » à proximité. Ces derniers peuvent être isolés, parfois tronqués à leur sommet, ou alignés horizontalement suivant la direction des plis et du versant. Ils sont particulièrement bien visibles en vue aérienne grâce aux outils de navigation virtuelle comme Google Maps.
En groupe, les "cœurs de Tata" sont plus ou moins régulièrement espacés avec une envergure décamétrique à hectométrique. Ils sont isométriques (Fig. 5) ou hétérométriques (Fig. 6). Dans un alignement horizontal, ils ne sont pas forcément uniformes et homogènes ; leur géométrie et leur taille dépendent de l'état d'avancement des processus de l'altération et de l'érosion du versant. Dans beaucoup d'affleurements, les "cœurs de Tata" ont une disposition étagée. L'étagement peut être topographiquement latéral, ou vertical avec une composante latérale ; il est étroitement lié à la répétition des plis (Figs. 7 et 8).
Conditions morphogénétiques
Nature lithologique des roches
Les "cœurs de Tata" sont faconnes dans les roches appartenant a l'Ediacarien terminal et au Paleozoïque inférieur, en particulier dans les séries carbonatées et gréseuses (Fig. 9). Ces roches s'organisent en bancs durs et souvent épais admettant des intercalations de roches tendres telles que les argilites ou les pélites, dont la présence facilite la plasticité de l'ensemble rocheux au moment de la déformation ductile.
Figure 5 : Exemples de dépressions en forme de Cœur isolée de la région de Tata.
- Région d'Aigou ; B- Région d'Imitek ; C- Nord de la ville de Tata, arasé au sommet
Figure 6 : Alignement de dépressions hétérométriques en forme de cœurs.
Figure 7 : Étagement vertical des dépressions en forme de cœurs
Les « Cœurs de Tata > : Geomorphosites du Sud marocain
Figure 9 : Étagement latéral des dépressions en forme de cœurs
Figure 9 : Colonne lithostratigraphique des roches du Paleozoïque inférieur de l'Anti-Atlas
Style des plis
Le cycle orogénique hercynien de la région de Tata est caractérisé par deux phases de déformation ductiles qui correspondent à deux phases de plissement de direction successivement subéquatoriale et subméridienne. Les plis sont généralement isopaques droits ou déjetés, ouverts et à grand rayon de courbure. Ce style change, pour la première génération de plis, au fur et à mesure qu'on s'approche des boutonnières précambriennes. Les plis présentent progressivement un déversement de plus en plus important alors que leur rayon de courbure diminue (Michard et al., 2008). Les observations effectuées sur le terrain montrent que les «cœurs de Tata » sont façonnés là où les plis sont dissymétriques, assez ouverts ou bien au niveau des flexures (figs.7 et 8). Ces géomorphosites sont sculptés aussi au niveau des dômes, en fait une structure plissée qui résulte de l'interférence des deux phases de plissement. Ce motif structural, typique de la région de Tata, est connu sous le nom "carton d'œufs", formé de dômes et de cuvettes.
Densité des diaclases
Les diaclases sont définies comme étant des fractures ouvertes sans mouvement relatif des deux compartiments qu'elles séparent et ne montrent aucun signe de broyage ou d'écrasement (Ramsay et al.1997).Il s'agit d'éléments structuraux très répandus dans les roches mais peu étudiés par la communauté géologique. La genèse des réseaux de diaclases est étroitement liée aux cycles orogéniques et à des événements tectoniques qui les ont accompagnés (distensions, compressions, exhaussements, subsidence ... ). Elle est facilitée par des facteurs externes tels que la pression fluide, la contraction thermique, les contraintes résiduelles (Engelder,1987 ; Suppe, 1985). Leur expression dépend, entre autres, de la compétence des roches.
Figure 10 : Schémas théoriques des réseaux de diaclases
Dans la région de Tata on remarque une très grande densité de diaclases qui s'organisent en plusiurs familles directionnelles et qui se superposent. Les fractures de chaque famille sont en général quasi-parallèles, planes, avec un espacement généralement assez régulier. Parmi ces familles on peut distinguer celles qui sont liées aux plissements régionaux et celles liées à des fractures locales (Fig. 10). Par convention, chaque direction d'une famille de diaclases est notée J. Si la roche présente quatre familles de diaclases, on utilise la nomenclature J1, J2, J3 et J4. Chaque direction est désignée par une couleur donnée afin d'en simplifier la lecture. La famille J1, perpendiculaire à l'axe du pli, correspond aux diaclases transversales ; tandis que la famille J2, parallèle à la direction axiale correspond aux diaclases longitudinales. L'étude de la distribution des réseaux de diaclases dans le sud marocain et particulièrement en relation avec les orogenèses hercynienne et atlasique (Ounaimi, 2004). Ce dernier a mis en évidence 6 familles de diaclases, J1 à J6, qui existent dans les deux chaînes et qui sont plus ou moins marquées selon les endroits. Les directions majeures dépendent uniquement des directions structurales, donc, du raccourcissement local ou régional. L'une des importantes conclusions de l'auteur est que ces 6 familles de diaclases (3 réseaux orthogonaux) semblent être présents et mémorisés dans les roches stratifiées, à l'état latent, et c'est l'un d'eux qui va s'exprimer et s'extérioriser sous forme de familles de diaclases principales, en fonction de telle ou telle direction de plis et de tel ou tel raccourcissement. Les autres réseaux latents apparaîtront plus tard, sous forme secondaire. C'est une notion qui dépasse même celles de l'héritage structural et du "défaut" initiateur de joints (Ounaimi, 2004). Les diaclases ont joué un rôle fondamental dans la morphogenèse des paysages caractéristiques de l'Anti-Atlas ; on les rencontre un peu partout dans la région de Tata. Leur densité et leurs empreintes sont très remarquables dans la région de Tata (Fig. 11). Elles ont contribué non seulement à différencier les "cœurs de Tata" mais aussi à guider la sculpture de beaucoup de paysages de la région. On peut même observer ces diaclases à l'échelle métrique et décimétrique dans les roches carbonatées En effet à l'affleurement, les couches géologiques montrent des sculptures linéaires multidirectionnelles qui correspondent à l'altération de la roche le long des diaclases. Ce façonnement a généré de véritables chefs d'œuvres de la nature, qui sont aussi emblématiques que les "cœurs de Tata". Ces roches fossilisent donc en grande partie les familles de diaclases qui ont affecté la région.
Figure 11 : Quelques exemples de réseaux de diaclases dans la région de Tata
Processus de l'altération et de l'érosion
Les diaclases peuvent s'élargir et ménager un sillon bien marqué par les processus de l'altération et de l'érosion.
Autrement-dit, toutes ces fissures sont autant de points de pénétration pour l'eau météorique, qui vient dissoudre et ronger la roche peu à peu et dont leur géométrie peut se répercuter directement sur la morphogenèse. Les zones les plus vulnérables qui sont privilégiées par ces processus correspondent aux points d'intersection des familles des diaclases qui se croisent. Les processus de l'altération et de l'érosion, responsables de la morphogénèse de l'Anti-Atlas sont très divers ; ils se sont succédés dans le temps depuis le Mio-pliocène jusqu'à ce jour.
Le 15/10/2025
Source web par : Laboratoire de Géologie Appliquée, Faculté des Sciences, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
www.darinfiane.com www.cans-akkanaitsidi.net www.chez-lahcen-maroc.com
Les tags en relation
Dictionnaire scientifique
Plus de 123.000 mots scientifiques
Les publications
Géo parc Jbel Bani

Circuits & excursions touristiques

cartothéques


Photothéques
Publications & éditions




