Recherchez sur le site !
Recherche avancée / SpécifiqueCatégories publications
+ Sciences De La Terre - Archéologie - Astronomie - Spéléologie - Ecologie - Pédologie - Volcanologie - L'hydrogéologie - Géomorphologie - Minéralogie - Pétrologie - Paléontologie - Géologie + Climatologie - Réchouffement climatique - Changement climatique + Plantes - Plantes Aromatiques - Plantes médicinales + Zoologie - Faunes + Botanique - Flors + Sciences humaines - Géo Eco Tourisme - L’anthropologie - L'Histoire - Démographie - Sociologie - Géographie - Patrimoine culturel
Géo éco tourisme inclusif

Géoparc et Recherche Scientifique
Le coins de l’étudiant



Blog Géoparc Jbel Bani
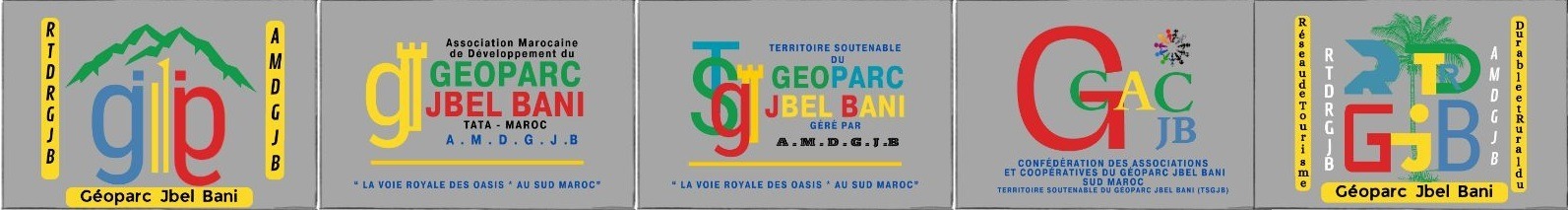
Les “Doigts de Singe” de Boumalne-Dadès (Sud marocain) : entre science et fascination, un joyau du patrimoine géologique éocène
Résumé
Les documents promotionnels du tourisme sud-marocain mentionnent frequemment un site paysager connu sous le nom de « doigts de singe », situe dans la vallee du Dades. Cependant, cette designation populaire s'accompagne rarement d'un cadre géologique descriptif ou explicatif. Ce geomorphosite correspond a une formation continentale rouge à dominante argilo-greseuse et conglomeratique, datee de l'Eocene superieur, appartenant au bassin tertiaire d'Ouarzazate. Ce bassin d'avant-pays, localise entre le Haut Atlas meso-cenozoïque au nord et l'Anti-Atlas precambrien et paleozoïque au sud- est, a joue un role cle comme zone de sedimentation continentale sous contrainte tectonique active. Le depot de ces formations resulte d'un environnement lagunaire influence par des apports fluviatiles grossiers issus de l'Anti-Atlas, transportes vers le nord sous forme de cones de dejection. L'histoire sedimentaire est contemporaine de la surrection progressive du Haut Atlas, amorcee au Cenomano-Turonien, qui induit une erosion accrue et un basculement structural vers le sud. Ces processus ont alimente la gouttière eocene en materiaux detritiques, avec des discordances progressives temoignant d'une forte interaction tectono-sedimentaire, egalement enregistree dans les formations neogenes du bassin.
L'evolution tectonique s'est accompagnee de la formation de six familles de diaclases, dont l'intensite depend de la lithologie. Ces fractures ont favorisé une circulation preferentielle des eaux meteoriques, a l'origine d'une erosion differentielle marquée. Cette dynamique a sculpte les morphologies emblematiques de la zone, interprétees localement comme les « doigts de singe ». Dans une perspective de valorisation geoscientifique, notre demarche consiste a produire des fiches synthetiques accessibles, permettant une lecture vulgarisee mais rigoureusement contextualisee de ces géomorphosites, en les intégrant pleinement dans le patrimoine géologique régional.
Abstract
Southern Moroccan tourism promotional materials frequently mention a landscape site known as "monkey fingers, located in the Dades Valley. However, promotors rarely support this popular designation with a descriptive or explanatory geological framework. This geomorphosite belongs to the Tertiary Ouarzazate Basin and corresponds to an Upper Eocene red continental formation, characterised by a dominant composition of clayey sandstone and conglomerate. This foreland basin, situated between the Meso-Cenozoic High Atlas to the north and the Precambrian and Paleozoic Anti-Atlas to the testify to a strong tectono-sedimentary interaction, also recorded in the Neogene formations of the basin. The formation of six families of joints accompanied the tectonic evolution, and their intensity depends on the lithology. These fractures favored the preferential circulation of meteoric waters, leading to a marked differential erosion. This dynamic sculpted the emblematic morphologies of the area, interpreted locally as the "monkey fingers". With a view to geoscientific
valorization, our approach involves producing accessible summary sheets that allow for a popularized yet rigorously contextualized reading of these geomorphosites, fully integrating them into the regional geological heritage.
I. Introduction
Dans les brochures touristiques du Maroc, ainsi que sur de nombreux sites web nationaux et internationaux, les composantes de l'industrie touristique mettent en avant les paysages emblématiques du sud marocain.
Parmi les sites les plus fréquemment cités figurent les géomorphosites de la région de Boumalne-Dadès, dont certains portent le nom évocateur de « doigts de singe ». Ces formations géologiques, constituées de matériaux argileux, gréseux et conglomératiques de couleur rouge, datent de l'Éocène supérieur.
southeast, played a crucial role as an area of continental sedimentation under active tectonic stress. The deposition of these formations results from a lagoonal environment influenced by coarse fluvial inputs from the Anti-Atlas, transported northward in the form of alluvial fans. The sedimentary history is contemporary with the progressive uplift of the High Atlas Mountains, initiated in the Cenomano-Turonian, which induced increased erosion and a structural tilting towards the south. These processes fed the Eocene trough with detrital materials, as evidenced by progressive unconformities that Malgré leur grande visibilité médiatique, ces formations sont généralement présentées sans explication scientifique approfondie. L'analyse des supports promotionnels révèle l'absence d'une contextualisation géologique rigoureuse ; on y trouve principalement des descriptions imagées et superficielles telles que : «versant recouvert de rochers rouges aux formes voluptueuses, évoquant une coulée solidifiée : ce sont les "doigts de singe"», ou encore : «conglomérats façonnés par l'érosion», accompagnées de remarques esthétiques telles que «il est étonnant de voir des styles de roches aussi différents si proches les uns des autres».
Par ailleurs, les guides touristiques locaux interrogés sur la nature géologique de ces formations témoignent d'une méconnaissance quasi-totale de leur origine et de leur histoire géodynamique. Pour certains, ces formes naturelles sont également appelées « cerveau de l'Atlas » ou « corps humain », et sont perçues avant tout comme des curiosités naturelles et un patrimoine à préserver, sans qu'aucune connaissance scientifique ne soit mobilisée pour les expliquer.
Les visiteurs, quant à eux, se limitent souvent à prendre quelques clichés souvenirs (voir planches I et II), sans bénéficier d'éléments d'information sur la valeur scientifique, culturelle ou patrimoniale du site. Cette situation s'explique notamment par l'absence d'outils de médiation efficaces et identifiables, susceptibles de mobiliser les différentes parties prenantes autour de la valorisation de ce type de patrimoine géologique.
Dans cette perspective, l'objectif est de faire connaître ces géomorphosites au grand public, en mettant en lumière leur valeur scientifique, culturelle, esthétique et économique. La mise en avant de ces éléments permettrait de renforcer l'identité des sites situés dans l'arrière-pays marocain et d'encourager leur intégration dans une dynamique de développement durable. Ce positionnement viendrait ainsi compléter les circuits touristiques classiques centrés sur le balnéaire et les villes impériales, en offrant de nouvelles motivations et opportunités de visite.
La démarche proposée pour la valorisation de ces géomorphosites repose sur l'élaboration de fiches d'identité accessibles non seulement aux spécialistes, mais également au grand public. Celles-ci intègreraient une contextualisation géologique régionale, accompagnée d'une explication simplifiée de la genèse et de l'évolution des formations étudiées. Concernant spécifiquement le site des « doigts de singe », une approche pédagogique et didactique, fondée sur un modèle explicatif vulgarisé, est envisagée afin de fournir aux visiteurs une meilleure compréhension de ce patrimoine naturel remarquable.
II. Contexte morphostructural
La région de Boumalne-Dadès, secteur touristique très fréquenté, est caractérisée par des paysages modelés dans des formations éocènes rouges argileuses, gréseuses et conglomératiques dites les "doigts de singe". Elle st située à 150 km à l'ENE de la ville d'Ouarzazate en empruntant la route nationale N10 jusqu'à la ville de Boumalne et en tournant au Nord de cette ville sur une distance de 15km (Fig. 1). Elle est constituée de quatre unités morphostructurales qui sont, du nord vers le sud, le Haut Atlas central, la zone subatlasique, le bassin d'Ouarzazate et le massif du Saghro (Fig. 2).
1.Le Haut Atlas Central
D'environ 2500 mètres. Géblogiquement, cette bande est constituée de formations appartenant au Crétacé, au Néogène et au Quaternaire. Sur le plan structural, elle est intégrée dans les plis situés à la bordure méridionale du Haut Atlas et se distingue par la présence d'un chevauchement vers le sud (fig. 3), affectant les dépôts néogènes et quaternaires subtabulaires de l'unité géologique adjacente (Choubert & Faure-Muret 1962; Laville et al., 1977; Errarhaoui 1997; Beauchamp et al., 1999).
Le relief du Haut Atlas a été initié dès l'Eocène supérieur entre -37 et-34 millions d'années (Missenard, 2006; Frizon de Lamotte & al., 2008).
Figure 1 : Situation géographique et cadre structural du secteur étudié
Figure 2 : Schéma cartographique simplifié de la Région de Boumalne
3. Le bassin d'Ouarzazate
Il se présente sous forme d'un couloir ovoïde constitué de plaines et de plateaux, de direction ENE-WSW, allongé sur une longueur de 160 km avec une largeur maximale de 40 km à Skoura. Sa surface est dans l'ensemble plane, entaillée par les Oued Dadès, Toudgha et Mgoun dont les ramifications drainent le flanc sud du Haut Atlas. Les différents villages sont localisés, pour la plupart, le long de ces cours d'eau. Son altitude moyenne varie entre 1100 et 1500 m. Le climat de ce bassin est aride à semi-aride, caractérisé par des précipitations irrégulières très faibles de 200 mm/an, des écarts importants de température et une forte évaporation en moyenne de 2800 mm/an (Agoussine et al., 2004).
Le bassin d'Ouarzazate est dominé par des formations détritiques continentales mio-plio-quaternaires
subtabulaires qui masquent l'ensemble des terrains plus anciens à l'exception des dépôts crétacés et paléocènes qui affleurent à ses extrémités orientale et occidentale.
Les épandages, surtout quaternaires, varient selon leur âge et leur position geomorphologique; ils sont constitués de conglomérats (poudingues et cailloutis) plus ou moins consolidés ou encroûtés aux bancs sablo-limono-argileux plus ou moins friables.
4. Le massif du Jbel Saghro
Le massif du Saghro constitue la limite nord de la chaîne de l'Anti-Atlas. Il s'agit d'une crête anticlinale orientée ENE-WSW, formée principalement de roches précambriennes et paléozoïques. Ces dernières comprennent des schistes, des grès et des quartzites avec des niveaux conglomératiques, mais surtout des roches volcaniques et plutoniques. Les roches les plus dures, comme les granites, peuvent atteindre des altitudes supérieures à 2500 mètres. En revanche, les formations plus tendres, d'origine sédimentaire ou magmatique, ont été érodées pour former de vastes plaines d'altitude, généralement situées entre 1300 et 1500 mètres.
En fonction de la répartition géométrique des diaclases, de la texture et de la composition minéralogique, les plutons présentent deux types de modelé : celui de massifs élevés en dômes, aiguilles, éboulis de blocs et celui de plaines à inselberg, chaos de boules, dos de baleine.
Le massif du Saghro offre des paysages ouverts, façonnés par de vastes vallées et de larges bassins creusés dans les formations tendres. Les formations rocheuses plus résistantes, telles que les calcaires, les grès et les quartzites, dominent ces dépressions en formant des crêtes et des cuestas. L'alternance entre couches dures et tendres a favorisé l'émergence d'une grande variété de formes structurales.
L'évolution morphologique actuelle du massif résulte d'un processus lent d'aridification, ponctué par des épisodes humides de plus en plus courts. Cette dynamique est principalement façonnée par le ruissellement, qui joue un rôle dominant, tandis que la gélifraction, encore active au-dessus de 2300 mètres d'altitude, intervient de manière plus marginale. Le ruissellement commence de façon diffuse sur les versants et les plaines, puis se concentre rapidement pour former des torrents lors des orages et des crues. Dans les grands lits d'oueds, ces crues entraînent le transport de galets et de coulées boueuses, soumis ensuite à la déflation éolienne. Ce processus contribue également à l'étagement des formations quaternaires et à la formation des glacis.
III. Synthèse géologique régionale
La région de Boumalne-Dadès est une zone charnière entre les deux grandes chaînes de montagnes du Haut Atlas et de l'Anti-Atlas. Elle constitue un bon registre géologique permettant de reconstituer les événements orogéniques précambriens, hercyniens et alpins. Presque tous les terrains de l'échelle internationale des temps géologiques y sont représentés, depuis le Précambrien jusqu'à l'actuel.
1. Le Précambrien
L’Anti-Atlas constitue la zone méridionale du Craton Ouest-Africain. Ce dernier comporte les roches les plus anciennes ; il a été structuré il y a environ deux milliards d'années lors de l'orogenèse éburnéenne (Rocci et al., 1991). Il correspond au support d'un second cycle orogénique polyphasé dit panafricain, représenté par une chaîne de montagne qui s'est formée entre 760 et 550 Ma : c'est la chaîne panafricaine. Les vestiges de ces deux chaînes orogéniques précambriennes se localisent au niveau des massifs et des boutonnières où ils sont recouverts par une épaisse série paléozoïque elle-même déformée par l'orogenèse hercynienne.
Le Précambrien marocain a fait l'objet de nombreuses études et de divers découpages. Pour simplifier on retient celui de Leblanc et Lancelot (1980) qui, sur des bases lithostratigraphiques et géodynamiques, a subdivisé les formations précambriennes en Précambrien I, Précambrien II inférieur (PII1), Précambrien II supérieur (PII2) et Précambrien III. La corrélation de ce découpage avec l'échelle stratigraphique internationale est indiquée sur la figure 4 : Le Paléoprotérozoïque correspond au Précambrien I, le Néoprotérozoïque regroupe le Précambrien II1 (850-685Ma), le Précambrien II2 (685-630Ma) et le Précambrien III (630-542Ma); tandis que le Mésoprotérozoïque, longtemps considéré comme absent dans l’Anti-Atlas, a été identifié récemment dans la région d'Ighrem (Ikene et al., 2017).
Dans le massif du Saghro le Précambrien I est presque absent ; tandis que le Précambrien II est représenté par un complexe ophiolitique, qui s'étend jusqu'à Bou Azzer, et par des sédiments d'eau profonde de type flysch d'origine surtout volcanique (tufs) entrecoupés de basaltes tholéiitiques comme les basaltes en coussins. Il s'agit de la série volcano-sédimentaire de Bleida contemporaine du système des calcaires et quartzites de l'Anti-Atlas occidental. L'ensemble de ces roches est affecté par des intrusions de microdiorites, diorites et gabbros calco-alcalins de l'Ougnat, du Saghro et du Siroua syn- à tardi-orogéniques des différentes phases de l'orogenèse panafricaine.
Le Précambrien III correspond à l'Édiacarien (Néoprotérozoïque terminal). Il est associé à une extension ayant permis le développement de demi-grabens, liée à une intense activité volcanique. Il est matérialisé par deux grands groupes lithologiques successifs recoupés par de nombreux dykes de rhyolite, microgranite, andésite et dolérite : la Série d'Ouarzazate et l'Adoudounien.
La série d'Ouarzazate, définie par Choubert (1952), affleure largement dans l'Anti-Atlas; elle est datée dans le massif du Saghro et ailleurs de l'Ediacarien (Thomas et al., 2004; Hawkins et al., 2001). Il s'agit de successions molassiques syn- à tardi-orogéniques (Hassenforder, 1987). Leur environnement sédimentaire reste peu différent de celui du Précambrien Il supérieur. La coupure établie entre le Précambrien III et le Précambrien (PII2) est caractérisée par l'existence d'une discordance angulaire (Leblanc, 1975), attribuée à la phase tardive de l'orogenèse panafricaine.
L'Adoudounien est un terme defini par Choubert (1952) le long de l'oued Adoudou au Sud de Tiznit dans l'Anti-Atlas occidental. Il marque le passage lithostratigraphique entre le Précambrien et le Paléozoïque. Il correspond donc à l'Édiacarien terminal.
A la fin de l'Édiacarien, vers environ 545 Ma (Gasquet et al., 2005; Maloof et al., 2005), une transgression venant du NW, envahit d'abord l'Anti-Atlas occidental et progresse en direction de l'Est pour atteindre une zone située entre Ouarzazate et Tazarine. La série sédimentaire est subdivisée en deux unités lithostratigraphiques : la Série de base conglomératique et les Calcaires inférieurs.
2. Le Paléozoïque
Les terrains paléozoïques, concordants sur l'Adoudounien, forment une couverture de plateforme; leur
structuration pendant l'orogenèse hercynienne y imprimera la forme actuelle de l'Anti-Atlas. Ils ont fait l'objet de nombreuses études thématiques dont celles de Destombes et al. (1985) ; Belfoul (1991) ; Bensaou et (1994); Soulaimani et al. (1997); Farazdaq (1997); Destombes (2006). La figure 5 résume les principaux repères stratigraphiques de ces terrains.
Figure 4 : Subdivision simplifiee des formations du Precambrien et du Cambrien de l'Anti-Atlas
3. Le Mésozoïque
3.1. Le Trias
Le Trias est représenté dans le Haut Atlas, où il marque le début de la genèse de cette chaîne. Cette période est caractérisée par la fragmentation du socle précambrien et paléozoïque, donnant naissance à des bassins structurés en horsts et grabens. Ces dépressions reçoivent d'épaisses séries détritiques silico-clastiques rouges, d'origine continentale, qui présentent d'importantes variations latérales d'épaisseur.
Figure 5: Principales formations geologiques paléozoïques de l'Anti-Atlas
Les principaux facies triasiques, pouvant atteindre une epaisseur maximale d'environ 1000 metres, sont constitués de conglomérats, de grès, ainsi que d'argiles rouges ou violacées, souvent entrecoupés de niveaux gypseux. Ces formations s'organisent en une série sédimentaire massive, au sein de laquelle s'intercalent des coulees de basaltes doleritiques datees de l'Infra-Lias (Bertrand & Westphal, 1977), en lien avec le processus de rifting associé à l'ouverture de l'océan Atlantique.
3.2. Le Jurassique
Au Jurassique, les dépôts sont contrôlés par un système de failles décrochantes réactivées suite à des distensions saccadees (Laville et al., 1977; Ibouh, 2004 ; Jossen et al., 1988). Ils se présentent en deux grands groupes de facies dans le versant sud du Haut Atlas : les facies carbonates du Jurassique inferieur et la base du Jurassique moyen, pouvant atteindre 1500 m d'epaisseur, et les depots continentaux forme de gres et de conglomerats du Jurassique moyen sommital.
Les études sédimentologiques et stratigraphiques des terrains jurassiques réalisées sur la frange méridionale du Haut-Atlas central ont permis de mettre en evidence un tres grand nombre de formations (Dresnay, 1976a et 1976b ; 1979 ; Ettaki, 2003 ; Ettaki et al., 2000; Mehdi et al., 2003 ; Ibouh, 2004 ; Ettaki et al., 2005 et 2007). Les variations laterales de facies et d'epaisseur de ces formations compliquent leur nomenclature et rendent leur corrélation difficile. Cela a conduit à une multitude d'interprétations paléobiogéographiques. Pour clarifier la presentation, une synthese est proposee en distinguant trois grands ensembles lithologiques selon leur âge (Fig. 6).
3.2.1. Les formations de la base du Jurassique inférieur
La base du Jurassique, représentée par la formation d'Ait Ras, débute par des calcaires dolomitiques et des dolomies gréseuses en plaquettes, alternant avec des mames greseuses. Cet ensemble, d'une epaisseur maximale d'une vingtaine de metres, est attribue a l'Hettangien-Sinemurien. Par endroits, cette sequence est surmontée, sur environ une centaine de mètres, par des bancs massifs de dolomie et de calcaire bioclastique à oncolithes, laminites et structures en tepee (formation d'Imin'Ifri). Ces dépôts évoluent latéralement vers des calcaires massifs bioconstruits (base de la formation de Chboucht), puis vers des facies hemipelagiques composes de calcaires noirs lites contenant brachiopodes, spongiaires, lamellibranches et restes d'échinodermes (formation d'Aberdouz).
Cet ensemble, date du Sinémurien au Carixien, est recouvert, dans le secteur de Todrha, par une centaine de mètres de dépôts carbonatés gravitaires riches en debris remanies de lamellibranches, ostracodes,
Échinodermes, algues et foraminiferes (formation de Todrha). Au Jbel Rat, cette serie est remplacee par des bancs plurimetriques de calcaire ou de dolomie présentant des « bird eyes », des oolithes, des pisolithes, ainsi que du calcaire oolithique à stratification oblique et de la dolomie à oncoïdes (formation du Jbel Raf).
3.2.2. Les forations du sommet du Jurassique inferieur
La serie du Jbel Rat est recouverte par une formation epaisse, d'environ 300 metres, appelee formation d'Aganane. Elle se compose de marnes versicolores alternant avec des calcaires lites riches en foraminiferes et en algues, ainsi que de dolomies metriques. Cette formation passe lateralement a des calcaires massifs bioconstruits appartenant a la formation de Chboucht et a la formation d'Ouchbis. Cette derniere, d'une epaisseur variante entre 140 et 300 metres, correspond a une alternance rythmique calcareo-marneuse deposee en environnement circalittoral a bathyal, evoluant lateralement, sur la plate-forme, vers un milieu mediolittoral proche d'une pente récifale.
Ces formations sont surmontees par la formation de Tagoudite, qui marque un tournant majeur dans la sédimentation liasique. Elle présente d'importantes variations latérales de faciès et d'épaisseur, avec un net épaississement d'ouest en est. Cette formation est caractérisée par des dépôts hémipélagiques constitués d'une alternance de mames gréseuses et de grès calcaires, se terminant au sommet par des carbonates de plateforme formés de calcaires construits et bioclastiques.
Enfin, ces depôts sont recouverts par une serie littorale appartenant à la formation de Tafraout. Celle-ci est constituée d'une altemance de marnes silteuses, verdatres à versicolores, et de calcaires oolithiques et biodétritiques à stratifications entrecroisées. Ces dépôts sont organisés en chenaux et barres décimétriques à métriques, avec la présence de niveaux lenticulaires de microconglomerats et de grès vers le sommet.
Figure 6: Principales formations geologiques mesozoïques du Haut-Atlas central
3.2.3 - Les formations du Jurassique moyen.
Elles débutent par la formation d'Azilal, constituée de silts, grès-calcaires et dolomies à lamellibranches et à gasteropodes surmontes par la formation de Bin El Ouidane. Cette dernière comprend deux barres de calcaires en plaquettes, à faune naine de lamellibranches et brachiopodes, séparées par une unité mameuse versicolore.
Vers le sommet, la sédimentation marine s'arrête et laisse place à des dépôts continentaux rouges formés de grès, silts et microconglomerats bruns chenalises avec dominance de la fraction grossiere vers le sommet (formation de Tilougguit). Ce niveau est surmonté de lentilles hétérométriques de conglomérats, grès, silts et argiles rouges contenant des ossements de vertébrés et de bois fossile (formation de Guettioua).
3.2.4. Conclusion
L'evolution spatio-temporelle des depôts jurassiques dans le Haut Atlas central se manifeste par des variations d'épaisseur et par la mise en place de divers types de faciès, reflétant une large diversité des environnements de dépôt. Cette dynamique sédimentaire résulte de l'interaction entre plusieurs facteurs : les oscillations eustatiques, la subsidence différentielle, l'activité tectonique synsédimentaire, ainsi que la structuration en blocs bascules le long de failles orientees NE-SW a E-W.
3.3. Le Crétace
Les affleurements du Crétace supérieur bordent 1'Accident sud-atlasique de façon continue d'ouest en est. Au nord et à l'extrémité occidentale du bassin d'Ouarzazate, leur épaisseur varie de 100 à 500 mètres. Ces dépôts reposent en discordance directe sur le socle paleozoïque, ou en legere discordance angulaire sur les roches triasiques (y compris les basaltes) et les formations jurassiques. Ils sont subdivises en trois formations principales (Gauthier, 1957, 1960 ; Laville, 1980) :
. L'Infra-Cenomanien (ou complexe rouge inferieur), constitue de grès et de conglomerats rouges contenant des éléments lithologiques similaires à ceux du socle de l'Anti-Atlas, et parfois des éléments calcaires d'origine jurassique. Ce complexe comprend également des intercalations de basaltes doléritiques, spilites, gypses, lignites et calcaires dolomitiques.
. Le Cenomanien-Turonien (Gauthier, 1957 ; Ettachfini & Andreu, 2004), aussi appele formation des calcaires lités à silex, représente un bon niveau repère régional. Dans la vallee de l'Oued Dadès, cette unité présente une épaisseur moyenne d'environ 30 mètres. Elle est composée de calcaires massifs, plus ou moins dolomitiques et compacts, renfermant des exogyres et des astartes, séparés par des lits mameux, et surmontés par des calcaires marneux lités contenant des rognons de silex.
. Le Sénonien (ou série rouge supérieure) : formé de grès, d'argiles rouges à gypses fibreux, de marnes gréseuses jaune-verdâtre, ainsi que de bancs de calcaire gréseux et de dolomies interstratifiées. Ces dépôts traduisent le début du retrait de la mer mésogéenne.
Sur le plan tectonique, les calcaires cénomano-turoniens se sont déposés au cours d'une période relativement calme. En revanche, le Senonien est marqué par une phase tectonique active, ayant entraîné la reprise de la subsidence du bassin et un retour à une sédimentation détritique, conséquence du soulèvement progressif de la région, deja affectee par l'erosion. Laville (1980) associe à cette phase la mise en place de la nappe de Toundoute. L'évolution structurale de la région de Boumalne-Dadès se caracterise par une longue phase de transtension anté-crétacée, liée à l'ouverture de l'océan Atlantique, et scellée par une discordance au Crétacé.
Par la suite, une période de sédimentation et de subsidence cénozoïque est suivie par un serrage tectonique majeur, actif depuis l'Oligocene jusqu'à l'epoque actuelle.
4. Le Cenozoïque
Les paysages de la région de Boumalne-Dadès sont dominés en grande partie par des formations cénozoïques.
Leur étude stratigraphique et leur relation géodynamique avec le Haut Atlas central ont été mises en évidence, entres-autres, par Herbig (1986, 1991) ; Trappe (1991) ; Brede et al. (1992) et par El Harfi et al. (2001).
Les formations du Cénozoïques forment, en fonction de leur environnement sédimentaire, deux grands ensembles litho-stratigraphiques (Fig.7): Le premier est constitué de dépôts marins transgressifs concordants sur le Crétacé marin ; le second présente des dépôts de nature continentale dans un bassin qui s'est individualisé entre le Haut Atlas central et l'Anti-Atlas. Ce bassin est contrôle par les événements tectoniques responsables de la structuration du Haut Atlas (Gauthier 1960; Gorler & Zucht, 1986; Fraissinet et al.,1988; Görler et al.,1988). Cette transition de lithologie, coïncide également avec une baisse eustatique, à long terme, du niveau de la mer depuis le milieu du Cretace et une transition climatique a partir d'un Cretace superieur-Eocene inférieur «mode chaud» à un Eocène supérieur-Quatemaire «ode cool». Les variations de faciès y sont très fréquentes, pouvant varier d'un environnement carbonaté et sableux côtier à un milieu de calcaires lacustres.
4.1. Les Formations marines
4.1.1. Formation d'Asseghmou
La série-type a été décrite à 5 km au sud du village d'Asseghmou, situé au NNE de Ouarzazate. Elle repose en concordance sur les formations rouges du Crétacé et elle se compose à la base de siltstones gris-vert à minces lits dolomitiques et des intercalations de paléosols. Au sommet, elle est constituée principalement de dolomies calcaires ou calcaires (mudstones) avec des gastéropodes marins et des intercalations de cherts.
4.1.2. Formation du Jbel Guersif
La formation-type a ete decrite au nord du Jbel Guersif dans la region de Qalaa't Mgouna. Elle commence généralement par un conglomérat, de 36 mètres d'épaisseur maximale, constitué de clastes de mudstones calcaires blancs provenant de la formation d'Asseghmou sous-jacente. Ce faciès est surmonté par des dépôts marins peu profonds, de calcaires bioclastiques à lumachelles et biostromes ; il date du Thanetien inferieur et moyen.
4.1.3. Formation de Ta'iouit Jbel
Datée de l'Eocène Inférieur (Yprésien), cette formation est décrite au Nord du Jbel Talouit dans la région de Kelaat M'Gouna, le long de la route menant vers Bou Tahar (Herbig, 1991). Il s'agit d'un ensemble détritique reposant en discordance de ravinement sur la formation précédente, d'une centaine de mètres d'épaisseur maximale, constitué à la base par des silts gris verdâtres à intercalations de grès fins, surmonté par un niveau blanchatre forme de calcaire a huîtres plus ou moins sableux. La serie se termine par des grès rouges plus ou moins carbonatés.
4.1.4. Formation d'Ait Ouarhitane
Elle est decrite à 8,5 km a l'Ouest de la ville de Tinerhir pres du village d'Ait Ouarhitane au pied sud du Jbel Tagount. D'âge Eocene Inferieur et d'épaisseur variable, entre 5 et 52 m, la formation Ait Ouarhitane est constituée de calcaires finement lités à lits mameux et à nodules et des intercalations de siltstones, de calcaires oolithiques et de lumachelles.
4.1.5. Formation du Jbel Tagount
La formation type a ete decrite a 8,5 km a l'ouest de Tinerhir, au pied du Jbel Tagount (Herbig, 1991). Elle est composée de lits de calcaires marins (wackestones, packstones et grainstones bioclastiques) de faible profondeur avec des intercalations de niveaux silicoclastiques à grains fins, constitués de siltites gris-vert. Son epaisseur moyenne varie entre 100 et 150 metres et son age se situe entre le Lutetien et le Bathonien.
4.2. Les Formations continentales
A la fin de l'Eocene moyen, la bordure sud du Haut Atlas Central a connu une importante baisse du niveau de la mer d'origine eustatique (Haq et al.,1987 ; Vail, 1987), marquée par un grand changement de faciès (Herbig 1986, 1991). Cette régression est matérialisée par l'apparition de dépôts lagunaires boueux avec des huîtres, évaporitiques et silicoclastiques pendant l'Eocène supérieur représentés par la formation d'Ait-Arbi.
Figure 7 : Principales formations géologiques cénozoïques du bassin de Ouarzazate
4.2.1. Formation d'Ait Arbi
La formation d'Ait Arbi (Trapp et al., 1994) dite « doigts de singe » est décrite dans la littérature géologique régionale sous différents noms : Formation de Hadida (Gorler & Zucht, 1986), Argiles à gypse (Roch, 1939), Couches rouges de Boumalne (Choubert, 1945), Couches des Ait Arbi (Gauthier, 1960), Formation Rouge Aznag et Formation NW Toundout (Fraissinet et al., 1988), Formation conglomératique de Ait Arbi (Gauthier, 1960), Membre Aït Arbi conglomeratique (Herbig, 1991). Cette formation, d'age Eocene superieur (Trapp et al., 1994 ; El Harfi et al., 2001), repose en concordance sur la formation du Jbel Tagount et presente une épaisseur variable entre 300 et 600 m. Elle s'organise en bancs metriques et decimétriques de roches rouges argileuses et gréseuses (Fig. 8) et présente souvent des lentilles de gypse primaire, silteuses, gréseuses et conglomératiques, montrant de nombreuses variations latérales.
Les conglomérats sont lenticulaires, constitués d'éléments anguleux à subanguleux, hétérométriques (d'une taille pouvant atteindre une dizaine de centimetres) et de natures lithologiques volcaniques et plutoniques (rhyolites, dacites, andésites, basaltes, dolérites, granites, ignimbrites et quartzites), provenant de terrains précambriens de l'Anti-Atlas (Fig. 9). La taille et la nature de ces eléments indiquent que la principale source d'apport correspond aux paleoreliefs du Bloc ancien du Haut Atlas et que leur transport etait relativement court (Herbig & Trappe, 1994 ; El Harfi et al., 2001).
Figure 8: Conglomérats polygéniques mal classés
Figure 9: Conglomerats rouges argileux et greseux
Les grès sont massifs et contiennent occasionnellement de rares lentilles conglomératiques. Ils présentent des stratifications entrecroisées, accompagnées de structures de courant à leur base. Leur granulométrie varie de grossière à moyenne, et ils sont généralement friables, avec une matrice composée d'argile et de limon.
La formation d'Ait Arbi est interprétée comme le résultat de dépôts en milieu alluvial de plaine, entrecoupée de chenaux appartenant à un système fluvial distal de type tressé (Fig. 10), avec des incursions marines initiales (El Harfi et al., 2001). En d'autres termes, durant l'Eocene superieur, la zone subatlasique et le bassin de Ouarzazate constituaient une nouvelle zone de sédimentation continentale reposant sur un substratum de roches marines. Ce milieu était caractérisé par des dépôts lagunaires boueux, des évaporites typiques d'une sebkha côtière (notamment le gypse), ainsi que des vases silico-clastiques, alimentées par des graviers et cailloux plus ou moins grossiers, transportés par un réseau fluvial enchevêtré.
L'émergence du Haut Atlas au cours du Cénomano-Turonien s'est accompagnée d'un basculement structural vers le sud, accentuant son érosion. Ce processus a renforce l'alimentation en sédiments continentaux de la zone subatlasique et du bassin de Ouarzazate.
4.2.2. Formation Aït Ouglif
Cette formation, d'épaisseur moyenne de 30 à 40 m, est décrite près du village d'Ait Ouglif et attribuée à l'Oligocene (Fraissinet et al., 1988 ; El Harfi et al., 2001). Elle est concordante sur la formation d'Ait Arbi, mais à de nombreux endroits elle est discordante sur les premieres structures plissees du Jurassique et du Crétace (Fig.11). Cela constitue une des preuves montrant que les premiers evenements tectoniques
compressifs, liees a la formation du Haut Atlas, se sont amorces pendant l'Eocene superieur ; c'est-a-dire au moment du depôt de la formation d'Ait Arbi.
Cette formation est constituée de bancs massifs de conglomérats polygéniques à galets hétérométriques de taille pouvant atteindre 1,20 m. les éléments sont arrondis et émoussés et proviennent de l'érosion de terrains essentiellement jurassiques et crétacés.
4.2.3. Formation Ait Kandoula
La Formation Ait Kandoula, d'age Miocene moyen-Pliocene (Benammi et al., 1995, 1996; Benammi &
Jaeger, 2001) comporte deux parties : l'unité d'Ait Ibrim et l'unité d'Ait Sedrat :
- Le partie inférieure ou Unité d'Aït Ibrirn, d'épaisseur moyenne de 400 m, est composée de calcaires lacustres, de travertins, de marnes, d'argiles, de siltstones avec quelques intercalations de niveaux
conglomeratiques et de gypse primaire. Elle est riche en fossiles : Ostracodes, Diatomees, Gasteropodes,
Bivalves, Algues (charophytes, oncolites, stromatolites), dents de Poissons et os de Mammifères.
Figure 10: Bloc-diagramme illustrant l'environnement sedimentaire de la zone dite « doigts de singe » a l'Éocene.
Figure 11 : Environnement sedimentaire des « doigts de singe > pendant l'Éocene
La dominance des calcaires palustro-lacustres et les fossiles trouvés indiquent qu'un grand lac continental s'est installe dans le bassin d'Ouarzazate. Celui-ci s'etend vers le Nord à Ait Kandoula et Ait Sedrat du Miocène moyen au Pliocène (Gorler et al.1988). Il s'agit d'un système de plaine alluviale palustro-lacustre qui a évolué vers le Nord en un système de cônes alluviaux provenant du Haut Atlas et vers le Sud, du côté de l'Anti-Atlas, en dépôts fluviatiles.
- La partie supérieure, ou Unité Ait Sedrat, repose en discordance angulaire sur les formations du Jurassique, du Paléogène, de la formation éocène d'Ait Arbi et du Crétacé. Elle domine la plupart des paysages de la vallée de l'Oued Dadès sur une épaisseur comprise entre 300 et 400 m. Du point de vue sédimentaire, cette Unité correspond à des méga-séquences positives formées de conglomérats, grès grossiers, grès fins, siltites, argilites et calcaires lacustres (Benammi et al., 1995). Les conglomerats sont massifs, constitués d'éléments hétérométriques (de taille pouvant atteindre 1,20 m), arrondis à subanguleux, dans une matrice de sable limono-argileux. Les éléments sont issus surtout de calcaire du Jurassique, grès, quartzites et rhyolites.
Sur la bordure nord du bassin, les données sédimentologiques de la Formation de Ait Kandoula mettent en évidence la progradation de cônes alluviaux au sein d'un système de plaines alluviales à influence lacustre (El Harfi, 1994 ; El Harfi et al., 1996).
4.2.4. Formations quaternaires
Les formations du Quaternaire ancien, d'une epaisseur avoisinant les 30 metres, reposent en discordance angulaire sur les unites mio-pliocenes de la Formation d'Ait Kandoula et du bassin d'Ait Sedra. Ces dépôts sont principalement constitués de conglomérats bien différenciés et consolidés, en contact net avec les niveaux sous-jacents. Les éléments conglomératiques présentent une hétérométrie marquée et une granulométrie plus grossière. Ces dépôts fluviaux anciens sont disposés en terrasses situées à des altitudes inférieures à la surface du Mio-Pliocene dans la vallee de l'oued Dades. Ils forment une plaine relativement continue, d'extension supérieure à celle de la plaine alluviale actuelle.
Les terrasses hautes et basses témoignent de plusieurs cycles d'érosion et de sédimentation s'étendant du Quaternaire ancien au Quaternaire recent. Elles sont caracterisees par l'accumulation de graviers fluviaux grossiers en lien avec la surrection continue du Haut Atlas (Gorler et al., 1988). Chaque cycle d'erosion et de dépôt est associé à des épisodes climatiques glacio-pluviaux, marqués par une augmentation significative des précipitations dans les massifs du Haut Atlas et de l'Anti-Atlas (Riser, 1988).
Actuellement, les rivières traversant les plaines alluviales poursuivent l'érosion des vallées du Haut Atlas en direction de l'oued Dadès, principal cours d'eau du bassin. Ces réseaux hydrographiques récents sont associés à des cycles d'érosion plus jeunes. Ils ont profondément incisé la partie méridionale des dépôts de bassin, et ont laissé plusieurs mètres de sédiments détritiques sur les surfaces planes des terrasses durant les phases tardives de chaque cycle pluvial.
La transition vers des climats arides interglaciaires, caractérisés par une diminution significative de l'apport hydrique, s'accompagne de dépôts de clastes grossiers sous forme d'épandages fluviaux localisés à proximité des fronts montagneux (Riser, 1988).
Enfin, des colluvions d'une épaisseur variant de 1 à 3 mètres apparaissent de manière discontinue le long des collines basses, notamment en bordure des lits actifs des rivières traversant les plaines alluviales.
4.3. - Tectonique synsédimentaire
L'analyse des différents faciès et la disposition verticale et latérale des faciès des dépôts de la série continentale du bassin d'Ouarzazate et de la zone subatlasique sont révélatrices de l'évolution tectonique et géodynamique affectant la chaîne du Haute Atlas. Sur la base des discordances entre les principales formations sédimentaires et les flux conglomeratiques dans le bassin d'Ouarzazate, deux phases compressives liees a la formation du Haut Atlas ont été mises en évidence (Frizon de Lamotte et al., 2000). La première aurait debuté dès l'Eocène
superieur, c'est-a-dire au moment du depôt de la formation d'Ait Arbi, et la seconde au cours du Pleistocene inférieur, au moment du dépôt de la partie supérieure de la formation d'Ait Kandoula.
IV. Processus génétique
Dans la région de Boumalne-Dadès, les formations de l'Eocène supérieur dites « doigts de singe » résultent du façonnement des formations rouges conglomératiques, le long des plans de diaclases selon différentes façons.
1-Les diaclases
Les diaclases sont définies comme étant des fractures ouvertes sans mouvement relatif des deux compartiments qu'elles separent et ne montrent aucun signe de broyage ou ecrasement. Elles s'organisent en réseaux composés de plusieurs familles, dont chacune est constituée par des diaclases parallèles de même direction.
Par convention, chaque direction d'une famille de diaclases est notee J. Si la roche présente quatre familles de diaclases, on utilise la nomenclature J1, J2, J3 et J4 (fig.12).
Figure 12: Schemas theoriques des diaclases. A : quatre familles de reseaux de diaclases J1, J2,J3 et J4 associees a un pli (d'apres Ramsay & Huber, 1987, modifie) ; B : Diaclases associees aux failles locales ou regionales (d'après Hancock, 1985, modifié).
La genèse des réseaux de diaclases est étroitement liée aux cycles orogéniques et aux événements tectoniques qui les accompagnent, tels que les phases de distension, de compression, d'exhaussement ou encore de subsidence. Ces fractures se développent en cohérence avec le plan des contraintes principales, et leur formation est favorisee par divers facteurs externes, notamment la pression des fluides, la contraction thenique ainsi que les contraintes residuelles (Engelder, 1985 ; Suppe, 1985). Leur manifestation dans les roches dépend en grande partie de la compétence mécanique de ces dernières.
- la famille J2 de direction N60 à N70, parallèle aux axes des plis (famille axiale ou longitudinale) est relativement régulière, non linéaire et anastomosée, avec une géométrie localement en lentilles à cause de l'hétérogénéité du matériel affecté.
- la famille J3 oblique, de direction N120 à N135, très espacée, présentant une faible continuité et à peine visible dans les facies compétents, ou encore perturbée par le caractère non lineaire et anastomosé de la famille J2
- la famille J4 oblique, de direction N40 a N60, fruste, souvent inaperçue du fait d'un grand espacement ou d'une faible continuité.
Les familles J1 et J2 sont plus précoces que les autres ; elles sont dominantes, toujours présentes dans la région et localement peuvent exister seules en reseau orthogonal. Elles sont liees au plissement ENE-WSW, lors du serrage majeur, donc au champ de contrainte regional (N150/160), parfois N-S, ou a un champ local N120/130 (Ouanaimi, 2004) ; tandis que les familles J3 et J4 sont probablement tardives rapportees aux plis NE-SW du raccourcissement atlasique.
2-Processus architecturaux
La formation d'Ait Arbi est fracturée par un réseau de diaclases désignées J1, J2, J3 et J4, qui constituent des zones de faiblesse favorisant les processus d'altération. L'eau d'infiltration s'introduit dans ces fractures, où elle circule en continu, entrant en contact avec les multiples faces cristallines des mineraux. Cette interaction entraîne des réactions mécaniques et chimiques, principalement avec les minéraux les moins résistants.
Les produits de cette altération sont ensuite mobilisés par les eaux de ruissellement, soit sous forme dissoute, soit a l'etat solide. Ces eaux, en raison de leur conductivite hydraulique nettement superieure à celle de la matrice rocheuse environnante, presentent un fort pouvoir erosif.
L'ouverture des diaclases a également été favorisée par les cycles de gel et de dégel associés à la contraction thermique durant le Quaternaire. Trois facteurs principaux ont ainsi joue un role determinant dans la genese des formes sculptées à la surface du niveau conglomératique de l'Éocène supérieur (Planches 1 et 2-A), connu sous le nom de « doigt de singe » : l'hétérogenéité de la roche, la géométrie des diaclases et la dynamique des fluides météoriques circulant à travers celles-ci.
Parmi les structures morphologiques observables, on note la presence de formes en « amandes », resultant d'une erosion differentielle selon les directions J1 et J3, tandis que l'alteration le long de J2 demeure limitée (Planche 2-B). Localement, l'alteration mécanique et chimique progresse en profondeur à l'intérieur des blocs conglomeratiques, principalement selon les directions J1 et J2. Cette évolution debute par l'isolement de formes cubiques, qui, sous l'effet de l'érosion, s'emoussent progressivement pour adopter une morphologie sphérique au niveau des plans de stratification (Planche 3-A).
Avec le temps, ces sphères évoluent verticalement en structures appelées « demoiselles coiffées », témoignant d'un phenomene d'erosion differentielle. Ce processus s'explique par une variation de la competence mécanique des matériaux, le sommet de ces formes étant constitué d'un faciès conglomératique plus résistant, surmontant un faciès gréseux plus friable (Planche 3-B).
V. Conclusion
Les dépôts continentaux de l'Eocène supérieur, communément appelés « doigts de singe », situés dans la région de Boumalne-Dadès, représentent un géomorphosite d'un grand intérêt géotouristique. Leur originalité morphologique, contrastant nettement avec les formations avoisinantes, constitue un attrait paysager majeur.
Ces formes s'integrent harmonieusement au cadre naturel des oasis ainsi qu'a l'architecture contemporaine locale (Planche 1).
Dans une optique de valorisation geotouristique, l'interêt de ces geomorphosites réside dans la mise en place de supports de médiation scientifique accessibles au grand public. Il s'agit notamment de fiches identitaires claires, illustrées, intégrant des éléments de vulgarisation scientifique. Ces documents devraient proposer une lecture simplifiee de l'histoire geologique de la formation, en utilisant l'echelle des temps geologiques et en soulignant les aspects géodynamiques et sédimentologiques suivants :
. Age des dépôts : Ces formations datent de l'Eocène supérieur, plus précisément du Priabonien, une
periode comprise entre 37,8 et 33,9 millions d'annees (selon la charte chronostratigraphique de l'IUGS,
2019), soit un intervalle de temps de 3,9 millions d'années.
. Contexte géodynamique régional : Les dépôts se sont mis en place dans un cadre tectonique marqué par l'emergence progressive du Haut Atlas, amorcee des le Cenomano-Turonien, suivie d'un basculement
structural vers le sud.
. Dynamique d'érosion et sédimentation : L'intensification de l'érosion des reliefs atlasiques a alimenté les bassins sedimentaires de la gouttiere eocene de Boumalne-Dades en materiaux detritiques d'origine continentale.
. Structuration fracturale : La formation est affectée par un réseau de six familles de diaclases, dont la
presence et l'expression varient en fonction de la nature lithologique des roches.
. Évolution morphogénique : A partir du Mio-pliocène, les processus d'érosion ont été guidés par ces structures fracturales, donnant naissance à des formes paysagères caractéristiques, notamment les célèbres « doigts de singe ».
Cette approche de valorisation, à la croisée des dimensions culturelle, éducative et scientifique des géosciences, permet une meilleure comprehension de la genese et de l'evolution spatio-temporelle de ces formations continentales. Elle favorise egalement une sensibilisation du public au patrimoine geologique local tout en renforçant l'attractivité touristique du territoire.
Planche 1 : Panoramas montrant les geomorphosites dits « doigts de singe > dans la region de Boumalne-Dades.
Planche 2 : La fracturation dans les facies du geomorphosite des « doigts de singe »
A : Differents types de réseaux de diaclases
B : Érosion sélective en relais.
Planche 3 : Differentes formes de relief observees dans le geosite des « doigts de singe >
A : Géomorphosite en boules
B : Au premier plan, erosion differentielle et naissance du relief dit des "demoiselles coiffees"
Le 23/10/2025
Source web par : Faculté des Sciences, Universite Mohammed V de Rabat, Maroc, Université de Cagliari, Sardaigne, Italie.
www.darinfiane.com www.cans-akkanaitsidi.net www.chez-lahcen-maroc.com
Les tags en relation
Dictionnaire scientifique
Plus de 123.000 mots scientifiques
Les publications
Géo parc Jbel Bani

Circuits & excursions touristiques

cartothéques


Photothéques
Publications & éditions




